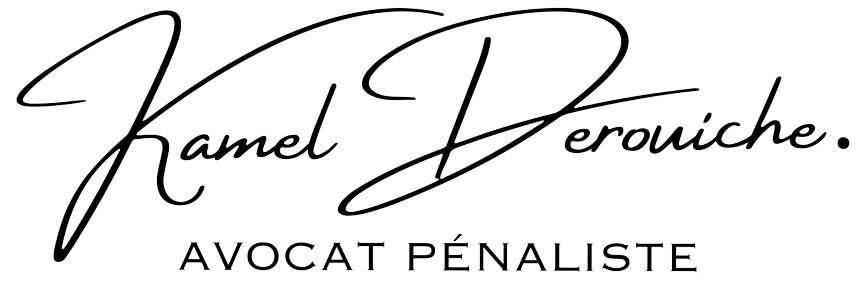Qu’est-ce que l’apologie du terrorisme ?
L’apologie du terrorisme est une infraction pénale définie par l’article 421-2-5 du Code pénal français. Elle consiste à présenter favorablement, publiquement, un acte terroriste, que ce soit par écrit, à l’oral, ou via internet, notamment sur les réseaux sociaux.
Cette infraction, qui vise à prévenir la radicalisation et à protéger l’ordre public, soulève de nombreuses critiques. Elle interroge la limite entre liberté d’expression et infraction pénale, en raison de son champ d’application flou.
- Contexte d’adoption de la loi
L’infraction d’apologie du terrorisme a été introduite par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cette infraction a été intégrée dans le code pénal par la loi du 13 novembre 2014. Depuis, le recours à cette qualification juridique s’est intensifié surtout après les attentats de janvier 2015 en France (Charlie Hebdo, Hyper Cacher). À la suite de ces événements, le gouvernement a voulu renforcer la réponse pénale, en élargissant les possibilités de poursuites pour des propos considérés comme dangereux.
Le contexte post-attentats, marqué par l’émotion collective et un besoin de sécurité, a entraîné une judiciarisation rapide de la parole, parfois au détriment des libertés fondamentales. C’est aussi à cette période que l’apologie du terrorisme a été placée sous le régime du droit pénal commun, et non plus sous celui des délits de presse, ce qui permet des poursuites en comparutions immédiates et donc le prononcé de peines d’emprisonnement fermes.
2. Définition juridique de l’apologie du terrorisme
L’article 421-2-5 du Code pénal punit :
« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes. »
Concrètement, cela signifie qu’un individu peut être poursuivi pour avoir tenu des propos perçus comme élogieux envers des actes terroristes. Il ne suffit pas de manifester une opinion critique : il faut qu’il y ait une présentation positive ou une justification explicite d’actes terroristes.
Cependant, la formulation volontairement vague de cette infraction pose problème. Elle laisse une grande marge d’interprétation aux juges, au risque d’aboutir à des condamnations arbitraires.
3. Une notion de « terrorisme » elle-même sujette à débat
Le flou juridique ne se limite pas à l’apologie : la notion même de terrorisme dans le droit français est large. Elle englobe :
- des actes violents ou menaçants à visée politique, religieuse ou idéologique ;
- mais aussi des actions visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Ce flou ouvre la voie à des dérives, notamment dans les poursuites visant des militants politiques, écologistes ou anticapitalistes, accusés d’“apologie” ou même d’“association de malfaiteurs à visée terroriste” pour des slogans, tags ou publications militantes.
Ce glissement sémantique et juridique soulève des inquiétudes majeures sur la criminalisation de la contestation politique.
4. Quelles sont les sanctions pour apologie du terrorisme ?
Les peines prévues sont sévères :
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
7 ans de prison et 100 000 € d’amende si l’infraction est commise en ligne.
Un simple partage de contenu jugé apologétique peut suffire à entraîner des poursuites. Des mineurs ont été condamnés pour avoir relayé de tels contenus sans intention claire, ni conscience des conséquences juridiques.
5. Des poursuites facilitées par les réseaux sociaux
Les plateformes numériques jouent un rôle central dans la diffusion de contenus litigieux. La vitesse de propagation, le manque de recul, et les malentendus d’interprétation rendent les réseaux sociaux particulièrement sensibles.
Les plateformes sont tenues de supprimer les contenus illicites, mais c’est le juge pénal qui doit apprécier le contexte, l’intention et le ton employé (humour, ironie, provocation…).
6. Des propos punis malgré la liberté d’expression
La liberté d’expression est protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Ce droit n’est pas absolu, mais il peut être restreint uniquement si cela est nécessaire dans une société démocratique. Le principe de base de la liberté d’expression est de ne criminaliser que les propos qui conduisent directement à des actes de violence. Mais depuis l’apparition du délit d’apologie du terrorisme dans le code pénal, le champ d’intervention du juge pénal s’est considérablement étendu.
Le risque de criminaliser l’opinion :
Des publications satiriques, maladroites ou militantes sont parfois jugées comme de l’apologie. Cela risque de transformer la justice pénale en outil de censure.
Surtout ce délit, interdit tout débat, politique sur la notion même de terrorisme, cette notion est floue et ayant justifié au cours de l’histoire de nombreuse répression des gouvernements contre les objecteurs de conscience
Par ailleurs, cette notion est relative. Un objecteur de conscience ou un militant des droits de l’Homme du point de vue occidental sera par exemple considéré comme un terroriste du point de vue d’une dictature.
La France n’est pas à l’abri de cet écueil et certains militants qui considèrent agir pour une cause juste ou se réclament de la désobéissance civile subissent le même traitement judiciaire que des militants au sein de dictatures à savoir l’incarcération pour une opinion. Cette situation s’est d’autant plus aggravée depuis que des personnalités politiques de premier plan ont été inquiétées pour leur positionnement politique voire convoquées, et auditionnées par des policiers.
7. Un parallèle historique : les lois scélérates
Les lois scélérates de 1893-1894, adoptées après des attentats anarchistes, visaient toute personne exprimant des idées jugées subversives. Elles ont été largement critiquées pour avoir restreint la liberté d’expression au nom de la sécurité.
Aujourd’hui, l’infraction d’apologie du terrorisme s’en rapproche en ce qu’elle permet de sanctionner des paroles, parfois immatures ou symboliques, sans lien avec une réelle menace terroriste.
8. Comment l’avocat pénaliste intervient face à une accusation d’apologie du terrorisme
Un avocat pénaliste peut invoquer :
- l’absence d’intention apologétique,
- l’humour ou la provocation artistique ou politique,
- la liberté d’expression garantie par la CEDH
- L’absence de caractère terroriste de l’acte dont il est fait l’éloge
Une analyse contextuelle et une comparaison avec la jurisprudence européenne permettent de remettre en cause certaines interprétations excessives de la loi française.
9. Conclusion
Aujourd’hui, l’apologie du terrorisme est traitée comme une infraction de droit commun, passible de peines lourdes et jugée en comparution immédiate. Pourtant, elle concerne avant tout des propos publics et devrait logiquement relever du droit de la presse, comme la provocation à la haine ou la diffamation.
En outre, la notion de terrorisme est une politique et non une notion juridique claire, ce qui con revient aux principes fondamentaux de sécurité juridique et de légalité, des délits et des peines.