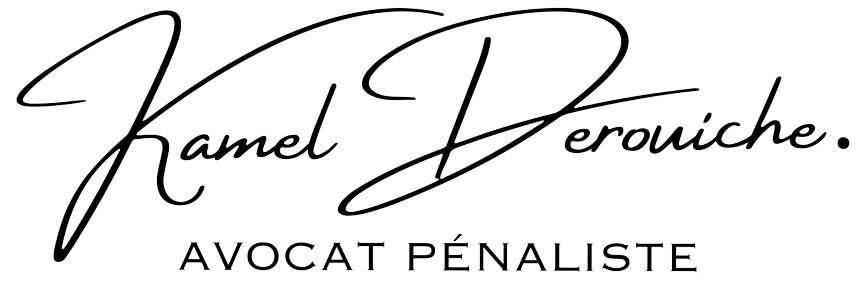Demande de mise en liberté : guide pratique par un avocat pénaliste
La demande de mise en liberté permet à une personne en détention provisoire de solliciter sa libération avant le procès. Elle doit reposer sur des arguments juridiques et factuels solides. Pour être acceptée, la demande doit être accompagnée de justificatifs d’un projet de sortie sérieux.
- Qu’est-ce qu’une demande de mise en liberté ?
La demande de mise en liberté est une procédure judiciaire qui permet à une personne en détention provisoire de solliciter sa libération avant son procès. Cette demande est formulée par la personne détenue ou par son avocat, qui doit présenter des arguments juridiques et factuels pour convaincre le juge que la détention n’est plus nécessaire. Elle doit être soutenue par un projet de sortie solide et des garanties de représentation, comme un domicile stable ou une caution.
2. À qui adresser la demande de mise en liberté ?
La demande doit être adressée à l’autorité compétente selon la phase de la procédure :
- À la chambre de l’instruction si la personne est renvoyée devant la cour d’assises.
- Au juge d’instruction en cas de détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire.
- Au tribunal correctionnel si la personne est renvoyée devant cette juridiction.
3. Comment faire sa demande de mise en liberté ?
La demande de mise en liberté peut être introduite de deux manières :
- Par l’avocat : L’avocat de la personne détenue se charge généralement de rédiger et de déposer une requête formelle. Cette demande peut être adressée à la juridiction compétente soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt direct au greffe.
- Par la personne détenue elle-même : Le détenu peut également formuler directement sa demande. Pour cela, il doit rédiger un courrier à l’attention du greffe pénitentiaire en sollicitant sa remise en liberté. Suite à cela, il sera convoqué au greffe pour remplir un document sous forme de formulaire pré-rempli. Dans ce formulaire, il devra notamment :
- Cocher la case correspondant à la juridiction saisie (juge d’instruction, tribunal correctionnel, chambre de l’instruction…)
- Indiquer s’il souhaite ou non comparaître personnellement lors de l’audience examinant sa demande
- Et préciser s’il accepte ou refuse de comparaître par visioconférence.
Cette étape est importante car elle formalise la demande auprès des autorités judiciaires et conditionne l’organisation de l’audience.
4. Quels critères sont pris en compte pour une mise en liberté ?
Le juge se base sur plusieurs critères légaux définis par l’article 144 du Code de procédure pénale pour décider d’accorder ou non la mise en liberté :
- Empêcher la disparition des preuves.
- Éviter les pressions sur les témoins ou les victimes.
- Empêcher une concertation frauduleuse avec des complices.
- Protéger la personne mise en examen.
- Garantir qu’elle reste à la disposition de la justice.
- Prévenir le renouvellement de l’infraction.
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public causé par la gravité de l’infraction.
5. Quels sont les délais pour obtenir une réponse ?
Les délais varient selon l’autorité saisie :
- Le juge d’instruction a 5 jours pour rendre sa décision. En cas de refus, il transmet la demande au juge des libertés et de la détention (JLD), qui doit statuer dans un délai de 3 jours.
- Le tribunal correctionnel a un délai de 10 jours pour répondre.
- La chambre de l’instruction dispose de 15 jours pour rendre sa décision, délai porté à 20 jours en cas de comparution personnelle.
- Enfin, lorsqu’une personne condamnée définitivement fait appel et dépose une demande de mise en liberté, le délai est porté à deux mois.
6. Comment se déroule l’audience de mise en liberté ?
Lors de l’audience, le juge entend les arguments de l’avocat et du procureur. L’avocat présente les documents et plaide en faveur de la libération de son client, tandis que le procureur peut s’opposer à la demande en soulignant les risques de fuite ou d’influence sur l’enquête.
La plupart du temps, la décision de mise en liberté est rendue le jour même de l’audience ou dans un délai de 48 heures.
7.Que faire en cas de refus ?
En cas de refus de la demande de mise en liberté, il est possible de faire appel devant la chambre de l’instruction. Ce recours doit être formé dans un délai de dix jours suivant la notification du refus.
8. Un critère tacite : la gravité des faits et de la peine encourue
Un élément tacite mais déterminant en pratique est la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. En effet, dans la pratique judiciaire, les juges hésitent souvent à remettre en liberté une personne qui risque une peine lourde, notamment dans des affaires criminelles. L’idée est qu’ils ne souhaitent pas accorder une remise en liberté pour ensuite réincarcérer la personne à l’audience. Cela conduit souvent à une situation où, dans la majorité des cas, à l’audience les peines ont déjà été exécutées pendant la détention provisoire.
9. FAQ : Tout savoir sur la demande de mise en liberté
Qui peut faire une demande de mise en liberté ?
La personne détenue elle-même ou son avocat peuvent déposer une demande auprès du juge compétent.
Combien de temps prend une décision ?
Le juge statue dans les délais prévus par la loi selon la juridiction saisie (de 5 à 20 jours, voire deux mois en cas d’appel). Dans la pratique, la décision est souvent rendue le jour même de l’audience ou dans les 48 heures qui suivent.
Peut-on faire appel en cas de refus ?
Oui, un recours est possible devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours suivant la notification du refus.
Est-il obligatoire d’avoir un avocat pour une DML ?
Non, l’avocat n’est pas obligatoire pour déposer la demande. Cependant, il est préférable d’être assisté par un avocat lors de l’audience devant le juge.
Quelles sont les chances de succès ?
Les chances dépendent des critères légaux remplis et de la gravité des faits reprochés. Chaque dossier est unique et doit être préparé avec soin.